007e Art - "James Bond — Une Esthétique du plaisir"
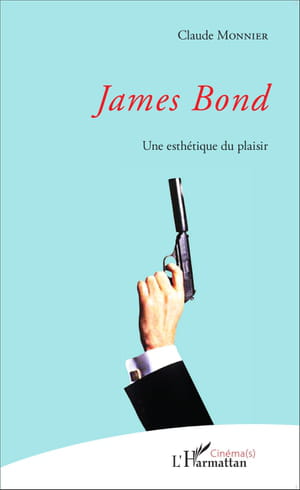
L’arrivée prochaine de 007-Spectre sur les écrans s’accompagne de la publication ou de la réédition d’un certain nombre d’ouvrages sur James Bond. Tradition oblige. Mais, au bout d’un demi-siècle, cette tradition a malheureusement tendance à se faire routine et à ronronner comme le chat du méchant Blofeld, puisqu’il est difficile de renouveler le genre. Catalogue des gadgets et des armes, répertoire des cascades, étude comparative des mensurations des Bond Girls (à quelques exceptions près aussi éphémères les unes que les autres — vous êtes-vous jamais penché sur la lamentable filmographie d’Ursula Andress ?), inflation des budgets d’épisode en épisode… Toutes ces considérations essentiellement descriptives finissent par devenir bien vaines, dans la mesure où elles ne suffisent pas à expliquer la longévité, pour ne pas dire la pérennité de l’entreprise, la manière dont le mythe parvient à se renouveler tout en restant fidèle à lui-même, à renaître chaque fois de ses cendres, dans un éternel retour résumé par l’écho quasi-incantatoire de la formule « Bond, James Bond ».
C’est pourquoi on se réjouit de voir enfin quelqu’un tenter autre chose, en tout cas dans l’édition française (les Anglo-Saxons s’y sont mis il y a quelque temps). Claude Monnier, dans son essai intitulé James Bond — Une Esthétique du plaisir, se refuse à étudier les gadgets ou les cascades en soi et pour soi, et entreprend d’analyser les « Bond » comme on analyse d’autres films, sans partir du principe qu’ils sont construits à partir de recettes, même si cet aspect des choses existe. La seconde partie du titre, Une Esthétique du plaisir, n’est pas loin d’être absurde, ou tout au moins redondante, puisqu’il est assez difficile de concevoir une esthétique du déplaisir, le travail de tout artiste consistant à nous faire voir le beau, et en particulier là où il ne se voit pas. Mais n’oublions pas que nous sommes en France. La Mère des Arts ne rigole pas lorsqu’elle théorise. Et il est évident que la notion d’esthétique, qui relève de la théorie, ne saurait exister sans un minimum d’ennui. Sinon, ce n’est pas sérieux… Or, dans la majorité des cas, on ne s’ennuie pas en voyant un « Bond », et on éprouve même un réel plaisir. Où l’art peut-il donc bien se nicher dans cette affaire ?
La question, à vrai dire, n’est pas simple, puisqu’elle revient à s’interroger sur le rôle des metteurs en scène dans les « Bond ». Le producteur Albert Broccoli a un jour déclaré dans une interview qu’il était hors de question pour lui d’engager un réalisateur à la personnalité trop marquée, un Roman Polanski par exemple, puisqu’il dénaturerait le mythe, et, comme le rappelle Claude Monnier dans son introduction, un article des Cahiers a réglé « définitivement » la question en expliquant que le metteur en scène d’un « Bond » n’était autre que Bond lui-même, le mythe finissant, tel le monstre de Frankenstein, par prendre le dessus sur tous ses créateurs. De fait, dans l’immense majorité des cas, les metteurs en scène des « Bond » n’ont jamais fait mieux que leur(s) « Bond ». Citez donc un non-Bond film (comme disent les Anglais) vraiment réussi de Terence Young, en tout cas plus réussi que Bons baisers de Russie. Avez-vous vu ce que Guy Hamilton, l’homme de Goldfinger, a livré quand il s’est avisé d’adapter à l’écran Agatha Christie ? Lewis Gilbert a-t-il jamais été plus inspiré qu’en tournant l’Espion qui m’aimait ? On nous permettra toutefois de nuancer un peu le principe avancé par les Cahiers. Bond n’est pas tant le metteur en scène des « Bond » que la caisse de résonance qui permet à ses différents metteurs en scène de s’exprimer, sinon plus librement, du moins plus complètement que dans leurs autres films.
Plutôt que de s’extasier par exemple sur l’exotisme des décors, Monnier préfère voir des « paysages choisis » — choisis pour exprimer ce que les personnages n’ont pas toujours le temps d’exprimer. La mer agitée du prégénérique d’Au Service secret de Sa Majesté est le signe destiné à nous annoncer d’emblée que l’histoire finira mal. L’important n’est pas que la couleur dominante de tel décor soit jaune ou verte ; l’important est qu’elle fait écho à la couleur d’un autre décor dans une autre scène. La descente de dizaines de ninjas le long de câbles dans le volcan d’On ne vit que deux fois n’est pas tant intéressante parce qu’elle est réalisée par des cascadeurs émérites que parce qu’elle est l’expression graphique d’une vengeance : elle rappelle le lent cheminement, le long d’un fil, de gouttes de poison mortel venues un peu plus tôt étouffer la compagne de Bond.
Claude Monnier n’est pas le premier à souligner l’importance des références politiques dans les « Bond », mais peu de commentateurs avaient jusqu’à présent étudié aussi précisément l’enchevêtrement de ces références politiques et de la psychologie (car il y en a une) des protagonistes de chaque épisode. On se borne à enfoncer une porte ouverte quand on signale que Meurs un autre jour parle des deux Corée. Monnier ajoute que cette gémellité contrariée est déjà présente dans l’ouverture du film avec l’usurpation d’identité qui permet à Bond de pénétrer en territoire ennemi et se poursuit dans la métamorphose physique du méchant qui constitue le nœud de l’intrigue. S’ajoute à cela le thème de l’eau, élément qui, tout comme le méchant, peut prendre différentes apparences, puisque, si fluide dans sa forme ordinaire, il peut devenir totalement figé quand le froid le transforme en glace. La voiture invisible, dite Vanish, qui est offerte par Q à Bond est à bien des égards ridicule, mais elle n’est finalement que l’extrapolation de toutes ces métamorphoses (y compris les retours de l’Au-Delà) qui s’associent pour donner au film son unité.
Et de telles « correspondances » existent d’un film à l’autre : la femme peinte en or de Goldfinger ressurgit immédiatement dans notre souvenir à travers la femme peinte en or noir (puisqu’il s’agit de pétrole) dans Quantum of Solace.
Il y a donc des girls, des méchants, des poursuites en voiture dans tous les « Bond », mais Claude Monnier cherche constamment le sens qui se cache derrière ces images. Il insiste en particulier sur la manière dont est traité le thème de la mort. Bond ne se contente pas d’éliminer ses adversaires comme les pions d’un jeu d’échecs. Le scénario s’applique toujours à faire préalablement exister ces adversaires. Ils ont toujours derrière eux, ils racontent toujours une histoire, qui n’est pas aussi caricaturale qu’on voudrait bien le croire. C’est ce soin apporté à la construction globale qui fait qu’il y a toujours, dans chaque « Bond », au moins une scène qui reste gravée dans les mémoires, alors qu’on serait bien en peine de citer quelque moment que ce soit dans la série des OSS 117, au demeurant très « distrayants », réalisés ou chaperonnés par André Hunebelle dans les années soixante.
La force des « Bond » est à trouver dans leur contradiction intrinsèque : de ces lourdes machines se dégage régulièrement une étonnante légèreté aérienne, peut-être parce qu’elles sont et restent, on ne sait par quel miracle, le fruit d’un travail artisanal, sinon l’expression d’un véritable génie artistique.
Certes, victime de sa dévotion pour la série considérée globalement, Claude Monnier est bien trop magnanime à l’égard de certains épisodes. On ne dira jamais assez à quel point l’Homme au pistolet d’or est un film mal fichu, malgré le vol plané (avec vrille) de la voiture par-dessus un fleuve. On ne dira jamais assez à quel point la musique « jazzy » composée par Michel Legrand pour Jamais plus jamais est « hors sujet ». Mais les analyses méticuleuses, séquence par séquence, sinon plan par plan, qui sont proposées dans cette Esthétique du plaisir devraient aider certains esprits dédaigneux à prendre conscience de l’importance de Bond dans l’histoire du cinéma, et dans celle du montage cinématographique en particulier, ce qui est probablement la même chose.
Un conseil toutefois. Il vaut sans doute mieux, à moins de connaître tous les films par cœur, et nous disons bien par cœur, ne pas entreprendre de lire cet ouvrage d’une traite. Prévoyez plutôt dans votre emploi du temps un mois ou une saison James Bond. Voyez chaque soir un film de la série et lisez ensuite le chapitre que Claude Monnier lui a consacré. Vous pourrez ainsi revivre « à domicile » les émotions et les joies des débats qu’on éprouvait il y a quelques décennies dans les séances de ciné-club, lorsque l’animateur était compétent et savait répondre aux questions qu’il avait lui-même posées.
FAL
Claude Monnier, James Bond — Une Esthétique du plaisir, L’Harmattan, juillet 2015, 26,50€


0 commentaire