"La Maison Blanche" de Léon Werth, une étude en blanc.
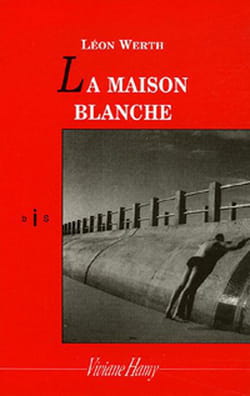
Mais Werth n’avait rien d’un conformiste et s’il vécu presque toujours en décalage par rapport aux normes de son temps, dû à un excès de lucidité peut-être, il fut bien trop passionné pour ne pas considérer la maladie comme une expérience à part entière. C’est alors avec une certaine jubilation, une force inattendue, qu’il s’attache à retranscrire le mal, non pas comme le ferait un mystique, mais comme un homme qui continue à vivre pleinement chaque instant.
« Peut-être les gens sauront-ils un jour tirer de la maladie une leçon de joie et de sérénité. »
Le narrateur est un jeune parisien au parcours chaotique. Rebellions et petits boulots l’amènent à vivre au jour le jour, la faim au ventre, jusqu’au moment où un concours de circonstances le fait devenir journaliste, section faits divers.
Une année faste l’autorise à s’accorder des vacances en Bretagne ; c’est là que la maladie le frappe sous la forme d’une otite qui dégénère. L’hospitalisation est rapide et la mort semble inévitable. Pourtant c’est aussi là que le roman bascule, comme un contre-pied au monde extérieur décrit dans les premières pages où la jeunesse et la santé furent confrontées au mépris d’un système rigide.
Le
narrateur entre dans la maladie comme un enfant fait ses premiers
pas, l’hôpital devient un havre et sa maladie
se transformera en une source de fascination. Une expérience neuve qu’il
observe à la fois comme un insecte étrange et qu’il tient à assumer de
plein fouet.
Pourtant la souffrance est réelle, violente. La douleur s’incarne, personnifiée. C’est une armée d’ouvriers qui s’applique à travailler ce corps suivant ses propres lois.
Les coups portés y sont précisément détaillés selon qu’il s’agisse de soins ou d’attaques imprévues.
Mais l'auteur méprise les poses et la complaisance. Même dans les pires moments le malade n’est pas ridicule, il est peut-être amusant, mais comme un bébé qui doit tout apprendre. Il se veut sous le scalpel comme une matière docile et tiens à être au plus juste de ce qu’il ressent, sans trop en faire si le mal est supportable. Il s’étonne que l’on puisse redouter de se faire transpercer la peau par un chirurgien expérimenté, qu’il compare à un artisan, alors que l’on peut tolérer la misère et la guerre. Un coiffeur est, selon lui, bien plus douteux qu’un médecin.
Son humour n’a rien du comique de chute. C’est plutôt une façon d’appréhender les choses, aussi cruelles soient-elles. Les événements s’auréolent d’un sourire permanent, un sourire qui n’est pas du cynisme mais juste une manière d’être, une disposition d’esprit communicative qui exclut la pitié outrancière et le pathos obligé. Une ironie qui épingle les clichés pour mettre en exergue ce qu’il y de plus grand chez l’homme, comme pour signifier que la vie vaut tout de même le coup.
Son écriture précise et taillée au couteau épouse, pour ainsi dire, idéalement le sujet. On sent paradoxalement, derrière un style détaché, une certaine nervosité, ou plutôt un caractère nerveux, en révolte, qui n’est pas sans rappeler le Calaferte de Septentrion, spécialement dans les passages où Werth évoque la rue de la Gaîté, avec très souvent ces envolées dont on ne distingue pas les rouages et qui imposent au lecteur des images d’une poésie profonde ; qui marquent tout simplement.
Ce sont les longues dérives sous morphine, comme une barque au fil de l’eau, où le narrateur s’amuse à décrire l’absence de sensations distinctes, le flou, le vide, l’imperceptible, ou encore ces infirmières, comme autant d’anges à son chevet, à la fois mères et amantes imaginaires et cette blancheur qui enveloppe tout ; ce blanc qui est devenu son cocon.
« Les petites roues, au grincement aigu, emportent sur le carrelage lisse quelque chose qui n’est plus mon corps, mais qui est moi-même. »
Enfin, il faudra sortir et apprendre à revivre hors du blanc, non sans regret. Le narrateur s’en sort et se demande en fin de compte s’il ne serait pas mort de dégoût sans sa maladie.
Un roman qui parvient à allier profondeur et légèreté, à prendre comme un témoignage privilégié nous priant de garder la tête haute, quoiqu’il en soit.
Arnault Destal
Léon Werth, La Maison Blanche, Viviane Hamy, « bis », janvier 2006, 173 pages, 7,50 euros



0 commentaire