Sous le feu, La mort comme hypothèse de travail
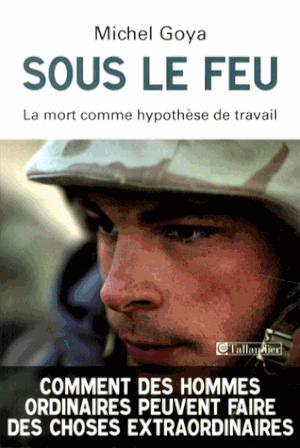
Après l'art poétique, voici le tour de l'art de la guerre de s'imposer, après cinq millénaires, fragment des sciences humaines. Cinq millénaires, j'exagère. Déjà, contre la doxa de son époque, le colonel Charles Jean Jacques Joseph Ardant du Picq (1) réinstalla l'homme au centre du combat. Pas étonnant que Debord ait tenu, dès 1978, après le départ des marchands de livres Guégan et Sorin, à inscrire au catalogue du temple du Champ libre L'Étude sur le combat, dont procède, entier, le salutaire et passionnant ouvrage du colonel Goya. Pour les années soixante (1800), le projet était neuf, puisqu'à deux parties théoriques consacrées, l'une à la guerre ancienne et l'autre à la moderne, Ardant du Picq ajouta la publication et les commentaires des questionnaires, qu'il avait pris soin de rédiger lui-même et de remettre à ses soldats ; corpus augmenté des lettres de ses hommes. Le Colonel ne souhaitait ni établir de cahiers de doléances ni monter par anticipation une affaire des fiches ; il ne s'agissait pas davantage de soumettre à la question la Grande Muette mais d'évaluer psychologiquement l'homme au combat, sous le feu, « nu dans la mitraille », de prendre acte de la violence inhérente à la situation et d'en tirer les conséquences congruentes dans la menée et l'organisation des batailles. Cette évaluation devait non seulement conduire à optimiser les performances des hommes sur le terrain mais à mener à une nécessaire réflexion sur les moyens de réduire les pertes humaines. En un mot comme en cent, éviter que le champ de bataille ne se mue en pur abattoir mais redevienne un terrain de combat. Inutile de dire qu'en 1914, l'état-major français fit assez peu cas de ce bon conseil et que les Anglo-Saxons lurent avec plus d'assiduité le chef-d'oeuvre posthume d'un mort au champ d'honneur. Premier servi, le Colonel périt en Romain, au Sud de Sotteville-lès-Rouen, sur la route de Gravelotte. Cuisse droite salement fracturée par un éclat d'obus, la gauche déchirée et sur le champ infectée, l'abdomen endommagé, le héros mourut quatre jours plus tard sans une plainte, au limen d'août 70, murmurant de la voix la plus ferme qu'il le put : « Ma femme, mes enfants, mon régiment, adieu. »
Sur ses traces, bravement, le colonel Goya, directeur de recherches au Centre de doctrine d'emploi des forces de l'armée de terre ; officier de marine et docteur en histoire après s'être illustré sur le terrain (Afrique et Balkans...) compose à l'usage du Pékin d'admirables ouvrages où le vulgaire comprend ce dont il ignore tout et devient, malgré lui, assez bon connaisseur de la plus aride des matières qui se puisse trouver. Honneur à lui !
Mettant à l'épreuve de la guerre moderne – le corpus s'étend de 1914 à 2013 – les deux principales théories de Maître Ardant du Picq « l'homme dans le combat fait le réel » et « le feu tue, exigeant de la guerre moderne que le combat désormais se fît à distance », le colonel nous offre sur un sujet douloureux et éprouvant un ouvrage savant et élégant, aussi agréable à libre, qu'il est intelligent et dense. Nombre de nos littérateurs devraient en prendre de la graine.
Sur le modèle de l'antique et merveilleuse collection « Les écrivains par eux-mêmes, » Goya choisit d'expliquer le combat par ses acteurs. Témoignages, récits de guerre ou romans, illustrent par l'exemple les différentes problématiques qu'il prétend accentuer: l'entrée du soldat en zone de mort et ses conséquences physiologiques, psychologiques, psychiatriques, la peur comme moteur ou frein, khathèkon ou accélérateur ; la part de l'individuel et du collectif dans le combat , celle de l'adrénaline et celle de la fraternité d'âmes,... Du singulier au collectif, suivant le chemin barrésien du Je au Nous, du corps de souffrance à l'esprit de corps...
Du sensible et de l'intelligence ensemble.
Lecteurs, nous combattons avec le combattant, nous découvrons le monde comme il le subit. Perception amplifiée, déformée, nous devenons ce rêveur éveillé dont le songe est un terrible cauchemar à trois dimensions, assourdi de mitraille et d'acier, soumis à l'horreur, que procure l'éclatement des corps, l'insensée violence et soudaineté des blessures, la puanteur des cadavres, l'étrange trouble né de la sensation d'être à la fois enfermé, étouffé et perdu dans l'immensité d'un désert : Jünger et Malaparte, dépouillés de l'allure de Fabrice del Dongo. Une fois le théâtre planté, Goya embarque son lecteur dans l'univers merveilleux des chercheurs : ce que cinéma, sciences sociales, nouvelles technologies de l'information, science, expérimentale, physique quantique, théories du chaos, biologie et anthropologie permettent d'entendre. Loin de tout dogmatisme et de toute posture idéologique, à partir de la seule expérience du terrain, inventer de nouveaux modes d'entraînement et instaurer des dispositifs susceptibles de rationaliser les ravages et de sauver le maximum de vies. En un mot, il s'agit d'inventer une science de réparation, capable de modérer le nécessaire en-sauvagement de l'homme.
Le sauvage, chassé par la porte, toujours, revient par la fenêtre
À la suite de Pascal, loin de tout angélisme penser le moyen de surmonter la bête sans la nier ! Dompter la folie, l'utiliser, la rendre dynamique et non plus mortifère. Vaste programme ! À la suite du Docteur Angélique, des juifs et des Grecs, se souvenir, qu' « un homme sans corps ne serait pas un homme » et qu' « un cadavre n'est plus un homme ». Pas plus, qu'un fantôme, cher Hamlet, ne le demeure encore. Spéculation n'est pas virtualité.
Nous sortons de cette lecture en tous points jubilatoire, revigorés et curieux de l'avenir, assurés de tenir un moyen théorico-pratique d'imposer silence au vacarme du thème majeur de l'obsolescence de l'homme, qui depuis 1918 empoisonne le poème européen. Du décadentisme au nihilisme et du nihilisme au rire sardonique ; un étrange « chemin qui ne mène nulle part » conduit de Spengler à Alain Soral les hommes à désespérer non pas du monde mais d'eux-mêmes. Symphonie pathétique où l'à quoi bon le dispute à l'indifférence. Faux tragique, inéluctable pourrissement, le modèle satano-biologiste domine. Gnose pour notre temps. En cette volonté d'abolir tout effort vers les Lumières du sens, les mauvais maîtres mènent à tombeau ouvert le monde à son inéluctable chute, substituant une logique de comptoir à la pensée spéculative. En langue commune : puisque nous mourrons seuls, désolidarisons-nous dès à présent de l'espèce humaine, réfutons l'idée même de l'homme et acceptons de vivre en insolents de Youtube, dans l'abjection et le refus de toute pensée. En cette posture, nier l'effort contrefactuel du « comme si » !
Les choses, en réalité, sont tellement plus simples que voudraient nous le faire croire nos maîtres es désespérances et complots. Selon Pascal « Tout le monde veut être heureux même ceux qui vont se pendre. » Tout guerrier souhaite, à l'instar d'Ulysse, s'en revenir à Ithaque, planter sa rame en terre et Achille aux Enfers se souvient avec tristesse du temps où il suivait la charrue paternelle. Ulysse et Achille pourtant sont allés à Troie. Il fallait bien, qu'ils y fussent allés, puisque Troie fut détruite. Qui, fous mis à part, transige avec le réel ? La paix de facto n'a jamais été qu'un bref espace de temps entre deux guerres. Rare mérite, l'ouvrage de Goya aide à penser par la pratique guerrière la possibilité de la paix, quand la vindicte pacifiste donne à penser de jure la fatalité de la guerre totale !
Les raisons de lire Goya
Si vous vous intéressez à cet art, si vous convenez, qu'aussi scandaleux qu'il doive, à l'instar de la mort, paraître à l'homme, « le phénomène guerre (2) » appartient au patrimoine humain ou si vous avez seulement envie de savoir ce que signifie « intervenir » au Biafra, en Somalie, au Sahel, aux Balkans, en Libye, en Afghanistan, au Mali, en Syrie, ce que les Gonziers y subirent, y subissent ou y subiront, lisez Goya.
Si vous croyez que l'idéologie ou l'endoctrinement font le soldat et non l'entrainement et la dynamique de groupe, lisez aussi ce livre, pour extirper de vos cerveaux intoxiqués par la propagande, tous les stéréotypes.
La guerre y redevient une ordalie (3), une épreuve panique mais aussi une des composantes de l'activité travail. Raison pratique, la guerre comme job, raison pure, les buts et la nécessité de se battre, esthétique du sublime offerte non seulement aux créateurs mais aussi à l'homme ordinaire, par cette occasion unique d'un possible dépassement de soi dans les limites d'une brigade, d'un groupe. Pour lui et pour l'humanité.
Rien ici d'une chromo en noir et blanc, le commentaire tardif de nos versions grecques et latines en langue claire. Aujourd'hui, il est vrai, nous lisons surtout des versions puniques et il semble qu'Hannibal fut en passe de vaincre Rome déchue. Un fragment d'Humanités où l'homme, en dépit des progrès de la technologie, aura toujours le dernier mot. C'est là, toute l'importance de ce livre, que ce le supplément offert à la jubilation. Oui, la guerre, comme la vie humaine, est une vallée de larmes, bornée par la certitude de la finitude, Thanatos, toute entière à sa proie attachée et pourtant... La guerre, comme toute réalité, demeure le lieu entre les lieux où s'expriment la douleur et le manque, le pays de l'épuisement, la province de la faim et de la soif, la vallée de la carence du sommeil, ce pays sans nom, que chaque conscrit, à chaque génération, avait devoir de visiter, sans Baedeker (4). Il en revenait, marqué, malade, fier d'avoir oeuvré pour le bien commun, qui la plupart du temps, se voyait traité comme un chien par ses frères de l'Arrière mais aussi un champ social où se déploie à l'envi le meilleur de l'homme.
En dépit de tous nos Apocalypticiens, heureux de proclamer depuis 1918 l'obsolescence de l'homme, le colonel Goya prouve par a + b, anthropologie, biologie, science expérimentale à l'appui, que tous les gestionnaires, qui ont traité la guerre comme Taylor et Ford, leurs ouvriers (un jour, il s'agira d'établir un lien structurel entre le fordisme de Céline et son pacifisme sentimental) ont échoué et que la cohésion sur le modèle de la « force atomique forte », seule capable d'unir les particules élémentaires fut, sera et demeure efficace. Verticale et horizontale, l'autorité et l'amitié (tout un) se propage du Chef à ses hommes et aux hommes entre eux : neuf marines qui ont déjà combattu ensemble ont plus de chance de s'en sortir que vingt champions qui ne se connaîtraient pas !
Le Colonel prouve aussi que la guerre moderne ne naît pas en 1914 mais avec l'artillerie et que chaque soldat désormais privé d'armure doit répondre au feu, sans s'occuper outre-mesure du piège numérique. Multiplier le nombre des morts, les compter par millions et peut-être demain par milliards, n'empêche pas ce fait brut : chaque soldat meurt pour lui, comme en silence meurt chaque homme. Émanciper l'individu demeure dans les deux cas le meilleur ou plus exactement l'unique antidote. Toujours le poison et la pharmacie !
La guerre, sous la plume du Colonel, s'impose modèle- recours, en un temps où la ruse ultime de la technique tient à cet art rhétorique de nous terrifier par anticipation. Le consumérisme s'étaye à cette peur, quand le récit de guerre nous reconduit à ce pays d'enfance où, nus et seuls, comme Robinson en nos îles, nous recréions le monde. Anticapitaliste ou chair à consommation, le faux sujet moderne, attaché à la guerre de tous contre tous, rate – c'est là toute la ruse du Capital et du Spectacle – le chant de confiance dans la vie. Ce chant, qu'aujourd'hui, familles disloquées, ego en proie à la volonté de jouir ici et maintenant, ont oublié, les gonziers et eux seuls, soldats d'une armée régulière et de traditions, cousus ensemble, en solitude, s'en souviennent. À eux, désormais de nous servir de modèles sociétaux, d'anti ou de contre modèle. Au plus vieux métier du monde réclamer la survie du monde.
Modèle-recours
« La force du loup est dans la meute ». Contrairement aux assertions pacifistes, la terreur du tyran vaut moins que la cohésion de la brigade. Dans la Wehrmacht, on dénombra tout de même au moins 13.000 fusillés pour l'exemple et l'on sait aujourd'hui le rôle tenu par l'usage de la Pervitine (5) dans la soumission inconditionnelle au Führer, sans oublier le vieil « adage soviétique (rappelant) qu'il fallait être très courageux pour être lâche dans l'Armée rouge. ». À la guerre, le maître mot demeure : confiance. Confiance en soi, gagnée de haute lice à l'entraînement et confiance dans les camarades. Contre l'ignoble modèle économique, qui prétend « individualiser » l'homme – il l'atomise en fait – le regain de confiance s'avère le dernier recours terrestre. Aussi le « phénomène guerre » offre-t-il le modèle d'une force susceptible de ré-agréger toutes ces particules malheureuses, soumises à si vive souffrance, au lieu, qu'en prétendant faire la guerre à la guerre, ces misérables, si abîmées en toutes les séparations, fractures sociales, affolées de mille pertes ethniques, culturelles et religieuses, labourent et ensemencent le terrain de guerres civiles.
Guerre de loisir contre job militaire.
La guerre civile, menée par des unités sans mémoire et sans rites, en absence de chefs légitimes, d'ordre et d'autorité constitutionnels redeviendra ce qu'elle était pour les Grecs anciens : la plus tragique des aventures. Lisant le Colonel, nous comprenons combien refuser de penser la guerre conduit à la stasis et découvrons la sagesse de cet art martial que constitue la guerre moderne.
Par l'efficace de la micro-stratégie opposée aux approches macro-stratégiques (6), Goya nous réapprend à penser l'organisation humaine dans la paix et à mesurer notre effroyable passivité civile face à la dictature du nombre. Notre résignation aura été grande ! Que dirons-nous à nos enfants ? À nos petits-enfants ? De quel air saurons-nous justifier notre insigne lâcheté ? En réfutant jusqu'à l'idée même de guerre, nous tournons le dos à l'effort civilisateur et préparons nos descendants à la stasis généralisée. Demain nous serons Hutus et Tutsis à défaut d'avoir soutenu nos gonziers dans des opérations de pacification. Et que personne ici ne parle d'économie seule. La paix et la richesse des pauvres fera le lit de la paix mondiale. Il est faux de prétendre toujours que l'homme ne fait la guerre que pour vendre des canons et du béton pour reconstruire les ruines. Les hommes font aussi la guerre pour que leurs femmes puissent élever leurs enfants et que ceux-ci s'instruisent : ce qui s'appelle vivre. Entrer en guerre équivaut à entrer en zone de mort. Pour que l'humanité entière n'y réside pas (7) il convient de lutter contre toutes les divisions fractales menaçant l'harmonie des sphères, de la sphère principale, nôtre, la planète bleue...
Goya, l’onomastique a dû jouer, rappelle à ces enfants pourris du Capital que nous sommes devenus, fils de Mac Luhan et d'Assange, – après Julien Sorel, Julian Assange ! – les réalités sensibles, les horreurs de la guerre, en un mot le réel, et nous remet au centre, quand toutes les autoroutes de l'Information prétendent nous reconduire au désert.
En ramenant la guerre au seul facteur humain, le Colonel nous donne à croire encore possible un ordre du monde, fondé sur une éthique de la responsabilité, susceptible de se voir validé, dans la guerre comme dans la paix. Ici et là, les caractères innés s'avèrent insuffisants à faire des vaillants. Le facteur chance existe dans les deux mondes. Carotte ou bâton ne sauraient avoir d'impact sur le comportement des hommes. Que valent promesses de médaille ou menaces de peloton d'exécution en cas de panique ? Peau de zob ! On vit, dans maints combats d'hier et de jadis, les hommes se jeter sous la mitraille, lâcher leurs fusils, s'endormir dans le vacarme des balles ou se terrer dans des trous d'obus, pour y attendre la mort ! On vit même des bataillons entiers comme des lapins sous des phares. On vit des soldats, morts sans avoir tiré une balle et des survivants qui agirent de même. Seule la confiance du soldat en son chef, transmise, maillon par maillon, à chacun des subalternes, délivre, sinon de la peur du moins de la panique nue, psychiatrique. Le stress, air connu, accentue l'angoisse quand la confiance en délie. Il convient de coudre les hommes ensemble, afin que, loin de toute tentation de fusion ou d'atomisation, ils devinssent ces arbres, poussant droit dans la forêt du sens chère à Kant et non ces arbustes courbes et torves, poussés, solitaires, à l'abri des écrans. La guerre peut, à certaines conditions, rectifier la courbure de l'homme en sorte qu'elle se rapproche de la droiture, en conservant toujours l'horizon d'attente de la paix. Tout guerrier véritable veut la paix et tout civil avachi devant sa télé, la guerre !
Contrairement à l'épreuve, une litote, endurée par la chose littéraire, la militaire ne s'en porte pas plus mal. Au contraire. Loin de l'aride contrée des essais tactiques ou stratégiques, des égouts de la déploration, comme de l'ardente colline aux honneurs, elle redevient ce que doit être une science humaine, accordée à une activité exceptionnelle accomplie par des hommes ordinaires et nous enseigne les conditions de possibilité d'un tel miracle, le sous-titre du livre proclame : « Comment des hommes ordinaires peuvent-ils accomplir des choses extraordinaires ?
Le colonel Goya, conférencier, que l'on peut entendre en cent lieux et aussi écouter et lire sur la toile (8), s'efforce, avec une redoutable éloquence depuis 2004, d'initier avec clarté un lectorat de non spécialistes à cette activité, qui n'est ni tout à fait de la sociobiologie ni de l'éthologie humaine mais une tentative d'analyser la guerre du point de vue de l'individu combattant.
Le syndrome traumatique.
La matière passionne d'autant plus, qu'il semble que nos sociétés soient malades, autant des guerres passées que des guerres futures. Nous pourrions, sans grand risque d'extrapolation, ajouter aux maux de notre temps post Auschwitz et post Hiroshima, gangrené par des guerres, auxquelles nos sociétés participent de toute la puissance de leur économie sans que la guerre totale fût vraiment déclarée, une sorte de syndrome pré-traumatique. Ce malaise rôdeur, pour n'être pas avéré, n'en est pas moins gênant ! Parfois un attentat, un commencement d'émeute, une menace, un acte délictueux réveille le dormant et condamne les fées cartésiennes à sortir de leur lit et à s'en aller battre la campagne. Le temps des imprécateurs, des faux prophètes, des exclus du succès revient pour le malheur commun.
Entre la célébration romantique de la « purification des pensées adverses par la fournaise de la guerre », le constat viandard et a-transcendantal, que délivre, implacable, Voyage au bout de la nuit ou à l'envi, déployée en une extase de paon, la sinistre érotique de la violence dans La Comédie de Charleroi de Drieu la Rochelle, il est bon, en attendant Godot et la paix perpétuelle, de revenir à la guerre, considérée comme ordinaire humain, troué ça et là, de quelques plages de paix. La guerre totale a déformé, marqué, tatoué, psychiquement autant que physiquement, l'homme moderne. Engagé volontaire, conscrit ou civil, l'épreuve a modifié durablement consciences citoyennes et consciences rebelles avec les conséquences que l'on sait. Désormais, l'horizon de la guerre se vit comme total. Il nous a fallu vivre avec ses revenants, comme nous devons vivre avec « la triste opacité de nos spectres futurs », nos ombres, à l'avance, clouées aux murs de villes épargnées par les bombes à neutrons... Génération de vétérans et non plus de « puceaux de l'horreur », il nous aura fallu apprendre à dompter la menace fantôme, doublée par la culpabilité de participer à la plus terrible des dictatures jamais inventée. Pas d'innocents en régime capitaliste.
Sous le feu... la mort comme hypothèse de travail. La guerre est aussi un job. Le soldat perçoit une solde qui, en cas de décès, se fera pension pour sa veuve. En outre, les enfants de morts pour la patrie seront – loi du 27 juillet 1917, étendue aux enfants des victimes des attentats ; puis en 2008 aux enfants et veuves des Harkis – , déclarés pupilles de la nation, qualité conservée toute sa vie, le pupille pouvant, après l'âge de la majorité, se tourner vers l'État afin que celui-ci l'aide à trouver un emploi, l'assiste lors d'une mauvaise passe et enfin lui offre un sûr et ultime asile dans une maison de retraite labellisée « bleuets ».
Pour le plaisir...
Avant que ne sonne l'heure de la déroute, lisez, si m'en croyez, n'attendez à demain, ce concentré en deux-cent trente pages du meilleur des films de Walsh, de Füller, de Schoendoerffer, de Spielberg ... En ce livre, la quintescence d'Orages d'acier, du Feu, de La Peau, de Kaputt, d'À l'Ouest rien de nouveau... Pas un livre de guerre, pas même le chef-d'oeuvre de Flaiano (9), Le Temps de tuer, prix Strega 1947, qui ne s'en trouve éclairé.
L'indice de vérité toujours augmente le plaisir du texte et nous trouvons à celui-ci l'intérêt, que nous trouvons toujours au Bildungsroman comme aux chansons du temps jadis... « Trois jeune tambours s'en revenaient de guerre »... « Pauvre Martin, pauvre misère »... Il nous chaut de savoir si le guerrier, l'initié passé à la grande essoreuse de l'ordalie, rentrera mutilé ou sauvé.
Tout le plaisir de lire ne tient-il pas – fictions, témoignages, études, essais – à la capacité donnée de vivre un instant, lecteur, une expérience inédite sans pour cela perdre le contrôle du sens ? Un classicisme passionné ou un romantisme corseté. De longtemps, je n'avais été aussi enthousiasmée par un livre.
Sarah Vajda
Michel Goya, Sous le feu, La mort comme hypothèse de travail, Editions Taillandier, janvier 2014, 20 eur
(1) Né en 1821
(2) Titre du fameux et bel ouvrage de Gaston Bouthoul (fondateur de la polémologie) paru en 2006, chez Payot.
(3) Epreuve judiciaire moyen-âgeuse qui consistait à s'en remettre au seul jugement de Dieu par une série d'éreuves physiques.
(4) Guide du voyageur moderne le plus en vogue au XIXe siècle.
(5) Une amphétamine dont l'armée allemande fit semble-t-il un usage excessif. Pas de guerre moderne sans drogue d'ailleurs. Du quart de vin des Poilus aux vétérans du Vietnam perdus dans Needle Park, l'histoire de la guerre moderne s'apparente à la solitude des champs de coton.
(6) Intéressées aux seules manœuvres de masse et aux nombres.
(7) Pas un scénario de science-fiction qui fasse l'économie de cet avenir radieux.
(8) Son blog : la Voie de l'épée.
(9) L'unique roman paru à la date sur la Guerre d'éthiopie, sans doute l'un des plus beau livre du monde, composé par le scénariste du jeune Fellini.


0 commentaire